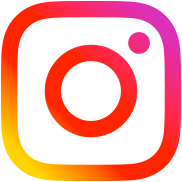Vincent Perrottet : « Partager le regard »
Plus que jamais et de façon croissante, nous évoluons dans des sociétés qui façonnent nos consciences par les images.
Chaque personne vivant dans l’espace urbain est confrontée quotidiennement à des centaines de messages visuels, informations commerciales ou de services publics qui communiquent sur leurs actes.
Ces images graphiques imprimées ou projetées occupent les trottoirs des villes, les quais et les couloirs des transports collectifs, les emballages, les pages des journaux, des magazines et des sites web. Les vêtements et les bâtiments s’en couvrent ainsi que bon nombre de véhicules.
L’espace public, et avec lui l’espace intime de chacun qui ne peut ignorer cette propagation, n’appartient plus à ceux et à celles qui l’habitent mais à ceux qui l’exploitent sans vergogne. Pire encore, le pouvoir sanctionne les détournements, graffitis, et autres formes inoffensives de résistance aux injonctions qui nous sont imposées par ceux qui se sont arrogé le droit de vendre l’espace commun. Il est stupéfiant que ces millions de messages visuels imposés à nos yeux et à notre intelligence ne suscitent aucun commentaire, aucune critique cultivée, comme s’ils n’existaient pas, comme si cela ne nous concernait en rien. Le regard que nous portons individuellement et collectivement sur cette production visuelle colossale n’intéresserait-il personne ?
Pourtant les enjeux liés à la production de sens par l’image sont gigantesques et concernent le monde dans son ensemble.
La représentation des personnes, des objets, des espaces et de la relation des uns entre les autres, l’expression des sentiments humains, du plaisir, de la souffrance et de l’indifférence, de l’organisation politique et économique des sociétés, donnent normalement à ceux qui en ont la charge, une responsabilité qui ne peut pas se situer hors des débats, ni fonctionner dans une opacité rendant possibles tous les abus.
Dans un monde se donnant à comprendre en grande partie par l’exercice du regard, ceux qui décident des images prennent un pouvoir qui devient totalitaire s’il n’est pas questionné démocratiquement.
Mais comment cultiver le regard de façon à le rendre ouvert, critique et citoyen plutôt que soumis et condamné à ce flot incessant d’ordres, d’injonctions et de messages infantilisants destinés « à faire rêver » comme le vend le monde publicitaire, premier producteur d’images ?
Les journalistes de la presse imprimée ou audiovisuelle se sont résignés depuis longtemps à accepter que leur outil d’expression soit soumis à la publicité et au chantage économique qu’elle exerce dès qu’on en vient à critiquer ses chefs, leurs clients ou leurs méthodes. Ils ont ce faisant perdu le crédit démocratique dont ils jouissaient, et n’ont pas à aller chercher bien loin les explications de la défiance que leur portent aujourd’hui ceux qu’ils prétendent informer. Ils se doivent de faire une belle révolution intellectuelle et essayer de comprendre le rôle de toutes les images dans les lieux où ils agissent.
L’Etat, son administration et les représentants élus du peuple ne se sont jamais engagés dans une véritable politique d’éducation du regard, aussi bien à l’école de la République que dans l’élaboration d’outils culturels qui proposeraient à tous une connaissance de l’histoire, des pratiques et des formes graphiques. Dans ce domaine, les quelques personnes qui y réfléchissent et travaillent à partager leurs connaissances et savoirs-faire ne trouvent aucun espace où s’exprimer, ni les moyens de la mise en oeuvre de cette culture démocratique pourtant si cruciale.
L’absence sur le territoire français de lieux dédiés à l’activité graphique rend impossible une véritable connaissance de ses formes, de son patrimoine et de son histoire.
Les grandes institutions nationales que sont le Centre Georges Pompidou et le Musée des arts décoratifs ont pratiquement failli à leur mission de culture du design qui leur était pourtant dévolue à l’origine. La Bibliothèque nationale de France qui fait un travail de collecte grâce à quelques personnes passionnées, conserve, sans pouvoir les montrer, des chefs d’oeuvre de l’art graphique. Celles et ceux qui connaissent le champ de l’expression du graphisme savent que de grands créateurs construisent des formes exceptionnelles. Ils essaient d’en faire profiter le plus grand nombre sans presque jamais y parvenir.
Les rares manifestations qui s’emploient à faire émerger une culture du design des images ( le Festival de Chaumont, le Mois du graphisme d’Echirolles, Une Saison Graphique au Havre, Graphisme dans la rue à Fontenay-sous-Bois, Les Rencontres de Lure… ) manquent cruellement de moyens, même si les municipalités qui les ont vues naître les subventionnent à la hauteur de ce qu’elles estiment pouvoir faire, mais que l’Etat néglige si l’on considère ce qu’il donne avec une grande parcimonie.
Il existe en France un nombre important d’espaces d’exposition, de conservation et de recherche pour les arts plastiques et l’art contemporain, mais ceux-ci n’ouvrent pas leurs yeux et encore moins leurs portes à une expression qu’ils semblent considérer comme mineure. S’ils ont compris qu’il existe chez les cinéastes, les photographes, les architectes et les designers d’objets de grands créateurs dont le travail est montré en exemple de ce que doit être la qualité proposée aux citoyens, ils peinent à accepter cela du design graphique.
Que pensent-ils de nos prédécesseurs ( Lautrec, Cassandre, Rodtchenko, Heartfield, Müller-Brockmann, Savignac, Rand, Tomaszewski et tant d’autres ) dont les travaux occupent pourtant les cimaises de grands musées dans le monde ?
Le fait que ces institutions culturelles soient elles-mêmes dans la position de commanditaire pour la mise en forme de la communication de leurs informations, associé à la manière qu’elles ont le plus souvent de traiter les graphistes en prestataires de services, ne facilitent pas la reconnaissance de cet art.
Alors comment considérer la faiblesse formelle et la vacuité intellectuelle de l’immense majorité des images imposées à notre regard dans les espaces publics et privés ?
Faute de lieux cultivant le goût des français, seules s’inscrivent dans la mémoire collective les images exposées dans l’espace public, presque jamais regardées et encore moins lues et décodées, mais qui, par la puissance de leur nombre, remplissent parfaitement leur mission de normalisation du regard par le bas : la transformation du citoyen en consommateur. Ces messages visuels condescendants et sexistes, qui n’informent jamais sur la réalité des produits ou des services qu’ils proposent, sont conçus par des agences de publicité et de communication dont le principal objectif n’est pas de réaliser des formes qui intéresseraient, en les éclairant, celles et ceux qui les regardent, mais de faire un chiffre d’affaires à la hauteur de ceux qui les emploient. En manipulant les affects et en simplifiant les messages, pour une supposée lisibilité ou clarté de la communication, ils deviennent un outil de propagande très efficace pour une société qui joue les individus les uns contre les autres dans l’obsession consumériste depuis les années 80. Le personnel politique et l’administration française pilotés par des conseils en communication en ont adopté les formes visuelles et la terminologie. La médiocrité du débat démocratique que politiciens et chroniqueurs déplorent ces temps-ci n’est que le miroir des formules simplistes et des recettes caricaturales de leurs conseillers.
Concurrence, compétition et compétitivité se substituent aux valeurs de la République que la publicité raille sans jamais n’être contredite.
Un système délétère s’est insinué dans la commande publique nationale, régionale et institutionnelle et rend presque impossible la production de signes ou de messages visuels de qualité, alors qu’elle devrait être exemplaire et que beaucoup de créateurs ont le désir de l’accompagner de leurs connaissances et de leur talent.
Depuis quelques années, sont apparus dans l’organigramme de ces institutions des responsables de la communication qui ont la charge de penser et d’organiser les informations de leur structure en direction des publics. Ils doivent gérer la relation avec les créateurs de formes, décider de l’économie des projets et de leur diffusion.
Ces personnes sont la plupart du temps incompétentes à remplir valablement leur mission. Elles sont sans formation liée au design en général et encore moins aux formes graphiques. Elles n’ont aucune connaissance quant à l’économie sociale des ateliers de création et peu de maîtrise des sciences humaines et sociales (sociologie, sémantique, sémiologie…) qui sont les sources avérées du design, indispensables pour penser et construire les formes.
Cette incompétence a pour effet de produire des consultations surréalistes où l’on demande aux studios de graphisme, systématiquement mis en compétition, de travailler des jours durant pour concevoir et réaliser des visuels sans être rémunérés ou ridiculement. De demander plusieurs solutions au créateur, alors que ce qui fonde la capacité de créer, c’est la capacité de faire des choix conceptuels et formels originaux, pas de faire semblant de donner le choix à des personnes qui sont rarement qualifiées pour juger de la qualité d’une oeuvre graphique.
Alors qu’ils ont la charge de guider leurs institutions par leur expertise (quand ils en ont une) et d’expliquer à leurs supérieurs les choix qu’ils font, ces responsables de la communication se soumettent presque toujours à l’avis non cultivé de leurs chefs. Responsabilité et communication se conjuguent mal à l’endroit du pouvoir.
La servilité convoquant l’arrogance, il faut les écouter nous dire les goûts des publics dont ils ne savent souvent rien faire d’autre que de les compter.
Comment dire l’immense circonspection des graphistes face à un responsable de la communication qui tient leur sort entre son infinie servitude et la puissance que lui confère sa place.
Les directions des institutions devraient se défier de celui qui donne toujours raison à ses supérieurs. En démocratie, la hiérarchie n’implique pas la soumission. Un responsable ne l’est que si on lui en confie le pouvoir, sinon il ne vaut rien.
Ici, nous tenons immédiatement à remercier celles et ceux qui, dignes de leur poste de responsabilité, permettent à la création graphique de proposer des informations claires dans des images remarquables. Ils se reconnaîtront et leurs structures avec.
A l’endroit de la création, ce ne sont pas les compétiteurs qui font avancer la relation entre les formes visuelles et le regard, mais ceux qui connaissent, pensent et pratiquent les formes. Les compétiteurs « gagnent » des marchés et des budgets mais perdent, dans l’énergie qu’ils y mettent, l’essentiel de leur disposition à créer, à toucher et réfléchir l’autre.
Pour une bonne relation entre la création et ceux qu’elle accompagne, il faut que chacun s’y retrouve. Le créateur doit faire son travail du mieux possible et le commanditaire, dont l’information apparaît publiquement, être fier de l’image qu’il donne aux autres.
Les affiches et publications exemplaires, que seuls les bons musées commencent à collectionner et à placer dans la perspective de tous les arts, le sont grâce à l’institution qui les a commanditées et à ceux qui les ont portées.
Réconcilier les citoyens avec les institutions peut se faire en repensant la façon dont les pouvoirs publics communiquent visuellement envers ceux qui les ont élus et les financent.
Prendre – par les images qu’on lui adresse – le peuple français pour un marché de consommateurs, c’est le réduire à la longue au grégarisme. Ne plus nous penser en citoyens responsables et solidaires les uns des autres, c’est générer les rivalités mortifères qui nous déshumanisent.
Le graphiste ( ou designer graphique ) est un généraliste de la mise en forme visuelle, il dessine «à dessein» – souvent dans le cadre d’une commande – les différents éléments graphiques d’un processus de communication.* Aujourd’hui la plupart des créateurs graphiques ont étudié cinq années après le baccalauréat dans des écoles supérieures d’art et de design, certaines sous tutelle du Ministère de la culture, et ont le plus souvent perfectionné leur formation dans des stages en ateliers ou agences de design en France et à l’étranger. Le temps qu’il faut ensuite pour que la production de ces créateurs se singularise, que leur écriture soit reconnaissable parce qu’incarnée, est un temps long. Ce sont dix années (exceptionnellement moins) de travail passionné, formel et intellectuel qui forgent l’indépendance d’esprit et la liberté nécessaire à toute création.
* définition donnée par une assemblée de graphistes en juin 1987 lors des États généraux de la Culture
Vincent Perrottet